« La drogue, c’est de la merde », dit le ministre de l’Intérieur au micro. Son gouvernement achète de pleines pages de publicité dans les journaux pour asséner que le cannabis favoriserait « l’échec scolaire », et serait responsable des « accidents domestiques » comme de « l’insécurité dans les villes », bien sûr. Ainsi, sous Macron, avec Gérald Darmanin, on découvre le niveau zéro de la politique, avec les gros sabots d’une propagande, un retour aux sources de la « pensée » prohibitionniste qui sévit depuis maintenant plus d’un siècle[1].
Un discours qui ignore superbement les réalités, qu’elles soient scientifiques, médicales ou sociales, pour se contenter d’une posture idéologique, tout en entretenant méthodiquement désordres, délinquance et crime organisé, mafias, cartels et guerres, partout à travers le monde.
Cet article a été publié sur le site de Guerre Moderne auquel Legalize est associé.
Faut-il rappeler que les Talibans viennent de conquérir l’Afghanistan avec pour « nerf de la guerre » pas tant leur idéologie, au fond très peu populaire, que leur contrôle du marché de l’opium, permettant de produire 90 % de l’héroïne consommée sur la planète ? Ce n’est pas non plus leur médiocre endurance de guérilleros qui a permis cette étonnante conquête du pays en quelques semaines – mais bien leur capacité à acheter les places à mesure de leur avancée, et ce, bien sûr, avec l’argent de l’opium. On compte ainsi peu de victimes sauf la liberté, et particulièrement celle des femmes, comme on sait. Il faudrait plus parler aussi de la menace d’extermination que les Talibans font peser sur les chiites, les Hazaras, chassés de leurs terres, et dont écoles comme mosquées ont connu les plus sanglants attentats de ces derniers mois, avant comme après la chute de Kaboul. Pour compléter le tableau, le système « judiciaire » le plus rétrograde, à la fois primitif et redoutable, très réputé pour ses performances, s’est imposé d’un coup à un grand pays.
Une catastrophe politique qui doit certes s’attribuer aux méandres de la diplomatie mondiale, et à l’action pour le moins équivoque des services de renseignement comme des stratégies militaires mises en place pendant vingt ans, qui auront tout fait pour renforcer leurs adversaires Talibans en prétendant les combattre. Mais cette défaite majeure des armées comme de la conscience occidentales repose pour l’essentiel sur les moyens extraordinaires que prodigue l’économie des drogues.
Faut-il rappeler aussi qu’au Mexique on compte un quart de million de morts de la guerre des cartels depuis vingt ans ? Vingt ans de coopération policière franco-mexicaine qui auront produit ce brillant résultat, les élèves de « l’école française » finissant généralement par nourrir les rangs des gangs de narcos. Ils seront même parvenus à implanter la technique des « disparitions » – si emblématique de la « guerre révolutionnaire », inventée en Algérie dans les années cinquante et largement employée en Argentine dans les années soixante-dix…
Ce n’est pas dans les favelas de Rio ni dans le quartier Nord de Marseille qu’on peut se féliciter de cette politique qui ne sait que renforcer la violence, maximalisant l’insécurité.
Il faudrait ainsi parler de la fabrique de l’insécurité, cette méthode policière si effroyablement cynique qui consiste à organiser soigneusement les conditions du désordre que l’État se charge de réprimer en veillant toujours à mieux l’entretenir, la « guerre aux drogues » étant en fait l’art de faire prospérer les trafics dans les pires conditions.
Exemple de la méthode : l’arrêté gouvernemental, en cours d’examen à Bruxelles, qui prévoit l’interdiction à la vente des fleurs de CBD, aujourd’hui distribuées légalement dans mille à deux mille boutiques réparties un peu partout dans le territoire français. Au lendemain de cette interdiction, c’est un marché au potentiel d’un milliard d’euros qui tombera dans l’escarcelle du crime organisé… On en prévient le gouvernement, sûr qu’il éviterait de faire une telle « bêtise » s’il s’agissait de combattre réellement la délinquance. Au contraire, il se frotte les mains. Plus d’activités criminelles entraînent plus de désordres, plus d’occasions de faire des déplacements sur la scène du crime avec son cortège d’images télévisées où le ministre peut mettre en avant sa mâchoire carrée, tout en réaffirmant virilement qu’il mobilisera tous les moyens nécessaires pour faire cesser ce scandale.
Le scandale ? Une voiture arrive à l’entrée de la cité, un type en descend et lâche une rafale de mitraillette au hasard sur les gens qui se trouvent là, dont un gamin de 14 ans qui meurt sur le coup. Ce qui ne ressemblait pas à un règlement de comptes ne serait au fond que simple publicité gouvernementale…? C’était à Marseille le mois dernier.
Non loin de là, à Montpellier, désormais ville pilote en matière de sécurité – avec sa toute nouvelle école de police, créée « sur le modèle de l’école de Guerre », suivant les recommandations présidentielles –, on a vu ces derniers mois des bandes terroriser librement le quartier de la Préfecture, en plein centre, sans croiser de patrouille policière pendant des heures… Les moyens sont ainsi « renforcés ».
Car c’est bien ce qu’il s’agit d’enseigner dans cette nouvelle grande école de la République : la subtile « guerre révolutionnaire », dont l’armée française se gargarise depuis la guerre d’Indochine, et dont on a pu voir les dégâts au Rwanda comme en Argentine, où l’on ne sait jamais qui joue à quoi, tant cela relève de la pratique de l’incendiaire, lançant des flammèches en tous sens. L’État, « le plus froid des monstres froids » – comme disait Nietzsche –, prend alors toutes les figures, trafiquant de drogue, révolutionnaire, voyou ou terroriste, pourvu que ça flambe.
Et « ça marche », certainement pas au sens où ça permettrait une « victoire » contre un « adversaire », la seule « victoire » ici étant d’entretenir le chaos autant que faire se peut.
La « guerre aux fleurs » que promet Gérald Darmanin est ainsi un comble. Sa police pourrait pourtant se féliciter de cette nouvelle mode, si innocente, des fleurs non psychotropes. Elle fait « rentrer dans la loi » non seulement nombre de consommateurs, mais une part significative du marché qui n’alimente plus les gangs et ne sert plus à payer des Kalach. L’actuel marché de ces fleurs légales paye des impôts, TVA, et charges sociales pour bien des jeunes et moins jeunes qui ont trouvé là un débouché sur le marché du travail, avec ces boutiques qui se sont multipliées par centaines pendant le confinement jusqu’à constituer aujourd’hui près de deux mille fonds de commerce. Et voilà qu’il n’y aurait rien de plus urgent que de les fermer…
S’il était réellement question de lutter « contre » les drogues, ce serait vraiment dommage, car on se détourne ainsi du plus étonnant instrument de réduction de la consommation de cannabis jamais vu. Faut-il comprendre qu’au fond le gouvernement ne se soucie pas plus de « santé publique » que de « sécurité » ? Ainsi, les moyens vont à l’encontre des fins déclarées. Les spécialistes peuvent certes se féliciter de constater comment le CBD aura fait apparaître, dans une bonne partie du public, un désir de ne pas subir d’effet psychotrope, en bénéficiant d’un effet de relaxation et de plaisir somme toute comparable, tel un parfait « substitut ». Le projet gouvernemental s’en moque.
Rappelons que la méthadone et les autres substituts, distribués aux héroïnomanes à fin de « réduction des risques », ont bien des effets salutaires, mais sont également psychotropes et addictifs. Ce qui n’est pas le cas du cannabidiol, adopté comme « substitut » par la clientèle de ces fleurs qu’il s’agirait d’interdire, qui n’a, lui, aucun effet négatif (hormis la combustion, lorsqu’il est fumé, laquelle peut s’éviter en ayant recours à des vaporisateurs). Le CBD avec ses fleurs permet de se défaire par soi-même d’une habitude qu’on fait ainsi évoluer spontanément dans le sens de la loi, suscitant un commerce légal, qui plus est sécurisé. Haro, crient en chœur Darmanin et Castex.
S’il fallait faire le bilan de ces commerces, depuis leur apparition il y a quelques années maintenant, on constate qu’il n’est que positif, à tous points de vue, en termes de santé comme d’ordre public. Or, les voilà menacés de fermeture au contraire parce qu’ils constitueraient une « menace à l’ordre public »… Pourquoi ? Parce que le gouvernement considère comme telle, la difficulté où la police peut se trouver parfois pour distinguer entre fleurs légales, au CBD, ou illégales, avec plus de 0,2 % de THC psychotrope. Pourtant, les dispositifs permettant de discerner existent, que ce soit par la simple obligation du paquet scellé par le détaillant, ou même par des contrôles faciles à exécuter avec un matériel portable qui ne ferait que compléter la panoplie policière.
On comprend que la « menace à l’ordre public » serait plutôt dans ce cas de nature idéologique… La « menace » que constituent ces si nombreuses boutiques qui ont parsemé tout le territoire, on le devine, c’est l’image qu’elles donnent d’un pays quasiment libéral. Or ce n’est pas du tout l’idée qu’entend promouvoir l’actuel gouvernement – qui plus est un gouvernement de campagne, dont les actes tendent à la réélection du président.
L’État – ou, plus exactement dans ce cas, le chef de l’État, candidat au renouvellement de son mandat – se positionne de façon volontairement rétrograde comme s’il y avait là un gisement de voix à s’assurer dans cette élection… On peine à suivre le raisonnement, mais il s’agirait donc d’offrir des gages aux segments les plus « durs » de l’opinion, ce qui s’entend dans l’hypothèse d’une confrontation avec l’extrême-droite : ne pas lui laisser ce fromage-là. Idem pour l’immigration, semble-t-il, si on en juge par la si brutale division par deux des visas pour Algériens, Tunisiens et Marocains, réponse directe aux dithyrambes d’Éric Zemmour…
L’idée de la guerre aux fleurs consiste à radicaliser la guerre aux drogues, la police recherchant une confrontation totale, sans pitié bien sûr pour les consommateurs de THC, pourtant si nombreux et plutôt tranquilles, et qu’il s’agirait de pourchasser plus que d’habitude. Tout comme les amateurs de CBD, qui n’enfreignent ni l’esprit de la loi – qui voudrait qu’on ne se « drogue » pas –, ni même sa lettre – de l’avis réitéré des Cours de cassation et européenne. Ces derniers, lorsqu’ils usent de fleurs de CBD ou en détiennent, même s’ils ne transgressent aucune loi, auraient le défaut de « compliquer la tâche » de la police. Un arrêté réglementaire suffirait à régler le problème.
N’oublions pas que la police doit « faire du chiffre ». Clôturant le « Beauvau de la sécurité », le président revendiquait comme un succès de sa politique les dizaines de milliers d’amendes forfaitaires, déjà distribuées à tour de bras, pour lutter contre ce qu’il appelle « le fléau des temps présents ». Et comme si ça ne suffisait pas, il réclamait « une véritable politique de pilonnage », de ces amendes « forfaitaires », à 200 euros, qui sont appliquées essentiellement aux plus pauvres, aux plus fragilisés, à ceux qui en sont réduits à se faire prendre dans la rue. Dans la salle, toutes les hiérarchies de toutes les brigades ont reçu le message.
À quelque temps de ce discours, fin octobre 2021, on apprend que « 4 608 opérations contre des points de deal ont été menées en France depuis le début de l’année ». Plus de dix fois par jour à travers le pays, sont ainsi lancées des « opérations », qui sont, à chaque fois, des mobilisations policières d’une certaine envergure, qu’on pourrait dire quasi militaire. En visite au commissariat du quartier Nord de Marseille, le président-candidat insiste sur son idée : « On va continuer de vous donner les moyens de pilonner. » Et il prend soin de préciser la cible avec emphase : « Il faut que tout le monde comprenne dans notre pays que les consommateurs de drogue sont des complices de fait. De fait. »
Pourtant, la veille, le mardi, la mise en œuvre du « pilonnage » présidentiel avait tourné mal, à Alençon. Certes, la police a pu « interpeller deux individus pour trafic de stupéfiants » dans une cité, mais la nuit le quartier a flambé. On comptait quinze véhicules calcinés le matin. Et beaucoup de forces de police pour essuyer « tirs de mortiers d’artifice et invectives ».
Que signifie ce dernier mot, rapporté par le journaliste de France 2 ? Pourquoi se mettre en colère, au point de déclencher une nuit d’émeute, et comment peut-on en venir à insulter de malheureux fonctionnaires, face à ce qui semble bien n’être que l’arrestation « normale » de deux délinquants ? La rage qui nourrit les injures émises alors informe sur le degré d’illégitimité de l’intervention policière, au moins aux yeux des amis des deux interpellés, qu’il faudrait appeler les « victimes » de cette politique de désordre public, et qui sont en tout cas perçus comme tels.
Il s’agit ainsi d’imposer une répression « bas seuil » tous azimuts, où il n’y aurait donc rien de plus urgent que la chasse aux consommateurs. Et les fleurs de CBD ? En quoi sont-elles concernées ? En rien, sauf qu’elles perturberaient le caractère expéditif des contrôles, où il n’est pas question de finasser et de s’embêter à vérifier si le jeune qu’on a « pris » enfreint réellement la législation des stupéfiants, ou s’il « semble » l’enfreindre. S’il fallait discerner, la meute des chasseurs de jeunes lancée à l’assaut des « quartiers » serait freinée, et comment réussir alors le « pilonnage » d’amendes présidentielles ?
On comprend que cette réglementation, comme l’extension du principe des amendes forfaitaires aux gamins qui s’attardent en bas de leur immeuble, n’est destinée qu’à entretenir le conflit chronique entre l’État et une proportion de plus en plus importante de la population, un conflit que la police aime plus que tout, et dont on pourrait même dire qu’elle en a besoin, que cela participe tant à son existence qu’elle ne saurait comment s’en passer. Le candidat-président serait-il intéressé à ce que des voitures flambent pour le décor de sa campagne virile ? Chercherait-il à se refaire une image de « chef de guerre » dans les banlieues pour faire oublier la déroute afghane et la débandade en cours au Mali ?
Cela relèverait d’un véritable « séparatisme d’État », où celui-ci se construirait en se confrontant, aussi fort que possible, à des « ennemis intérieurs », essentiellement imaginaires, qui seraient non moins nécessaires à sa structuration même, au déploiement du maintien de l’ordre et au contrôle social le plus rigoureux, celui qui remplit rapidement les prisons.
La mise en scène d’une politique « tough on drugs », « dure avec les drogues », est connue comme un marronnier, une sorte de gadget électoral qu’il serait bon de sortir à toute occasion, en dépit de ses insuccès manifestes. « Just say no », proclamait Nancy Reagan, au début des années quatre-vingt – et le crack a déferlé aussitôt sur Los Angeles par l’entremise de douteux agents de la CIA, avant d’inonder le pays, montrant les drogues auxquelles on était invité à dire « non » sous un jour particulièrement inquiétant, comme pour mieux illustrer le propos… Le drame sanitaire, social, judiciaire et pénitentiaire qui s’ensuivit pèse encore sur la misère américaine, et se sera abattu si violemment qu’on a pu dénoncer là un sommet « génocidaire » des politiques de ségrégation.
Plus récemment, de 2006 à 2012, au Mexique, sous la présidence de Felipe Calderón, on a pu admirer un cas d’école : dès le premier jour de son intronisation très contestée, Calderón décidait d’augmenter les salaires de la police et de l’armée et, dix jours plus tard, dans l’espoir de trouver là une légitimité, alors que son élection était toujours incertaine, il lançait la guerre totale contre les drogues. Au résultat, l’armée sera déployée, avec son cortège de victimes civiles « collatérales », et certes des chefs de cartels seront aussi liquidés, mais la criminalité globale ne fera qu’augmenter spectaculairement… 120 à 125 000 morts violentes auront été comptabilisées au cours des six années de cette présidence horrifique.
Ce n’est pas vraiment anecdotique si l’architecte de la politique antidrogues sous Calderón, son ministre de l’Intérieur, Genaro García Luna, est aujourd’hui en prison à New York, soupçonné d’avoir été carrément proche d’El Chapo, grand patron du principal « cartel »… Il est accusé d’avoir reçu des valises de 3 millions de dollars (plusieurs…), et participé au blanchiment de beaucoup plus d’argent encore.
Loin d’être un cas, ce ministre de l’Intérieur s’inscrit dans la lignée de la plupart de ses prédécesseurs, au moins depuis la présidence de Carlos Salinas, de 1988 à 1994, dont le frère aura lui aussi été en prison, une bonne dizaine d’années, avant d’être « blanchi ». Il y avait aussi là le Franco-Mexicain, José Cordoba Montoya, qui n’aura pas été vraiment inquiété, lui, après six ans aux côtés d’un Salinas ambitieux modernisateur, lequel a porté le pays en tête des États narcotrafiquants, non sans que Cordoba Montoya ait dirigé personnellement, entre autres choses, la si importante politique « antidrogues ».
On pouvait lire alors, dans l’hebdomadaire Proceso, des comptes rendus d’écoutes téléphoniques qui fuitaient abondamment dans une ambiance de fin de règne, marquée par l’irruption zapatiste, et plus encore par l’assassinat du candidat désigné à la succession, Luis Colosio. L’élimination de ce candidat réformateur permettra que soit élu un protégé de Cordoba Montoya, Ernesto Zedillo. Mais la retranscription du dialogue enregistré portait sur tout autre chose : au bout du fil, le tout-puissant secrétaire de la présidence parlait avec sa petite amie d’une livraison de 2 tonnes de cocaïne dont il s’inquiétait de savoir si elle était bien arrivée…
Il y aurait « problème » si ce n’était un système bien huilé. Un président ne vole jamais seul. Et son successeur ne fait que la même chose. Faudrait-il dire, à la satisfaction générale ? Car il s’agit bien d’une méthode de gouvernement. S’il n’y avait qu’un problème de corruption, la police finirait par faire son travail, et il ne resterait plus que des politiciens honnêtes. Or, de présidence en présidence et de ministre de l’Intérieur en ministre de l’Intérieur, de responsable de la lutte antidrogues en responsable de la lutte antidrogues, la sinistre comédie se répète, encore et encore. Pourquoi ?
C’est qu’hormis son effroyable pouvoir de corruption, la prohibition a une grande vertu : celle d’étendre à l’infini les moyens de la police. Non seulement elle trouve là prétexte permanent à l’augmentation de son budget, mais l’ensemble que constitue ce qu’on appelle « le crime organisé » ne peut subsister, de fait, que sous contrôle policier. Une illustration de cette évidence se trouve dans les raisonnements opposés à toute légalisation du cannabis parce que la police perdrait le contrôle des banlieues où les dealers participent, bien sûr, au maintien de l’ordre.
Ce dernier argument ne manque pas de pertinence, même si son cynisme laisse pantois. En effet, toute légalisation du marché du cannabis devrait se soucier de la déstabilisation économique qu’elle ne manquerait pas de produire en retirant ce qui représente une bonne part du « PIB » des « quartiers ». Aujourd’hui cette manne – qui « ruisselle » dans l’économie locale jusqu’à remplir les frigos et payer les cartables des petits, ainsi que des sociologues ont pu l’observer depuis longtemps –, est sous le contrôle de « caïds », eux-mêmes sous le contrôle de la police, comme tous ces dealers auxquels on donne le choix entre aller en prison ou collaborer, les deux solutions pouvant se panacher au besoin, et ce à tous les étages du trafic. On comprend le point de vue policier, qui dispose là d’un outil remarquable, sans parler de l’avantage qu’on peut trouver à manipuler un budget sensiblement plus important que les pourtant peu négligeables contributions publiques affectées à la sacro-sainte « sécurité ».
Cette histoire est connue depuis les origines de la dite French connection, qui fit scandale, et même un film, dans les années soixante-dix. On apprenait alors comment les « services gaullistes », au sein du SDECE, ancêtre de l’actuelle DGSE, organisaient le trafic d’héroïne approvisionnant l’Amérique du Nord. On pourrait même remonter, dans les années 30, aux temps de la « concession française » de Shanghaï, où s’abritaient tous les trafics, y compris d’héroïne, avec la complicité des autorités en poste, et où le futur colonel Trinquier faisaient ses premières armes.
Quelques temps plus tard, en Indochine, le même Trinquier participait à organiser le transfert de l’opium produit par des paysans laotiens à sa demande, dans cette région qu’on appellera par la suite le Triangle d’Or. Opium que les services français acheminaient en hélicoptère et en avion bi-moteur vers la mafia vietnamienne à Saïgon, pour approvisionner fumeries et « lieux de plaisir ». Au passage, les paysans planteurs de pavot formaient une base excellente pour constituer des maquis anticommunistes…
On assistera à un mouvement très semblable à Marseille, qui était la grande ville communiste de l’après-guerre, en France. Les dockers de la CGT refusaient de charger sur les bateaux les armes destinées à l’armée coloniale qui accessoirement combattait les communistes vietnamiens. Pour reprendre en main les docks, avec le renfort de la CIA, on fit appel aux voyous, lesquels réussiront effectivement à conquérir le port, sans lésiner sur la violence, faisant de nombreux morts. En échange de ses bons et loyaux services, la pègre marseillaise se voyait confié alors rien de moins que l’essentiel du marché mondial de l’héroïne, sa transformation dans des laboratoires clandestins et l’approvisionnement des États-Unis. Sponsorisés dès le début par les services américains, les voyous se verront dans le même temps associés de très près aux services français. Le colonel Fournier dirigeait les opérations, et des agents du SDECE transportaient les centaines de kilos de poudre blanche, faisant la soudure entre ses producteurs marseillais et leurs homologues de la mafia américaine, qui l’écoulaient dans les rues de New York ou de Chicago.
Beaucoup plus récemment, c’est le commissaire François Thierry – patron de l’OCTRIS, théoriquement en charge de réprimer le trafic de drogues international (la fameuse brigade des Stups ne s’occupant que de l’intérieur) –, qui est accusé d’avoir trafiqué du cannabis par dizaines de tonnes. Ce n’est certes pas une nouveauté, les très étroites relations franco-marocaines étant au cœur de la French connection, depuis ses origines. Grâce à quoi le haschich marocain a représenté jusqu’à 90 % du cannabis européen, transitant sur un parcours balisé, les « routes » étant « achetées », passant en somme des services marocains aux services français, avec au besoin la complicité de la police espagnole, sur ces « routes ». Le patron de l’OCTRIS est soupçonné d’avoir réceptionné le haschisch par tonnes jusqu’en bas de chez lui, ainsi qu’on découvrira, en grande partie suite aux révélations d’un fonctionnaire désabusé, fatigué d’être impliqué jusqu’au coup dans un vulgaire trafic de stupéfiants, dont la destination était tout sauf contrôlée[2].
Le journaliste Emmanuel Fansten révèlera cette affaire dans Libération, et François Thierry poursuivra en diffamation Fansten et Libé, alors même qu’il doit répondre devant la justice pour ces faits effectivement dénoncés par voie de presse. Après quatre ans de procédure, la cour de cassation rejettera définitivement la plainte du commissaire. Quant aux enquêtes le visant, elles sont toujours en cours d’instruction. En attendant, celui qu’on pourrait qualifier de plus grand dealer de tous les temps n’aura été que muté – à la sous-direction anti-terroriste.
L’affaire François Thierry se présente comme une histoire de flics véreux, mais c’est l’évidence qu’il s’agit de trafics d’État, comme a pu conclure Libé. Car c’est de rien de moins que vingt tonnes de haschich par mois qu’on parle là ! Ce qui correspond aux deux tiers de la totalité de la consommation estimée nationalement. Le trafic est ainsi tellement centralisé que l’essentiel passait directement entre les mains du patron de la police internationale des stups…
La manne honteuse tirée du marché mondial des stupéfiants compte aussi pour les services secrets, pas moins que pour la police. Car elle leur permet non seulement une augmentation significative de moyens, mais bien une sorte d’autonomie, ce budget secret étant indépendant des dotations qui leur sont attribuées officiellement. Pour leurs donneurs d’ordre comme pour les exécutants, ce n’est pas un mince avantage que de n’avoir aucun compte à rendre pour certaines opérations. Les plus politiques des services de l’État disposent ainsi de plus de moyens et plus de libertés. On comprend que ce qui est bon pour eux ne l’est pas forcément pour la démocratie, surtout lorsque ça contient la possibilité d’une absence totale de contrôle pour des entreprises si secrètes qu’elles peuvent tout se permettre, très au-delà du concevable. Si cette marge d’autonomie intégrale des services est, de fait, mauvaise pour la démocratie, pour la politique étrangère, en revanche, les drogues sont carrément une aubaine, ce qu’on pourrait appeler un instrument géopolitique de luxe, qui permet d’intervenir un peu partout, que ce soit au nom de la prétendument vertueuse lutte « antidrogue » internationale, comme au Mexique, ou dans le cadre de stratégies marquées au fer de la « guerre révolutionnaire », toujours perverses, et pas toujours pour le meilleur, comme on a pu voir en Afghanistan, entre autres. L’alliance avec la dictature narco-trafiquante birmane, indéfectible depuis une trentaine d’années, en est un exemple particulièrement scandaleux, à l’heure où Total finance l’armée qui tire sur le peuple.
Si on acceptait un instant de réfléchir en termes d’économie, et non de pseudo-sécurité (ou, pire, de diplomatie parallèle), la question reste entière des banlieues effectivement sinistrées, où le marché noir des drogues apporte probablement plus que toutes les aides sociales très insuffisantes. Insuffisantes en particulier pour les jeunes, qu’on contraint quasiment à la délinquance en les plaçant hors du dispositif du RSA jusqu’à 25 ans… Certes, il ne serait pas absurde de corriger ce défaut des politiques sociales qui se révèle si peu avantageux, y compris en termes de sécurité publique. Laisser les jeunes à l’abandon n’est pas la meilleure façon de les protéger, ni de protéger la société contre eux lorsqu’ils prennent mal l’injustice qu’on leur inflige et finissent par faire des « bêtises ». Dans un contexte où le deal peut se voir comme la « moins pire » des solutions, le revenu d’existence[3], que proposent certains, trouverait là une application plus que vertueuse – y compris pour la lutte « antidrogues » qu’on veut mettre en avant –, en offrant une alternative.
*
Il faut rendre hommage ici à Yoland Bresson (1942-2014), un des pères de ce « revenu d’existence », dont il se voulait modestement co-inventeur, et auquel il a travaillé toute sa vie. Lorsque son idée est reprise, on omet toujours que, dans sa définition, il s’agirait d’un revenu attribué à l’individu du simple fait de son « existence », et donc dès le début de la vie. Ainsi, Yoland Bresson proposait qu’un « compte d’existence » soit ouvert à la naissance, compte sur lequel l’argent s’accumulerait mensuellement jusqu’à la majorité légale. Ainsi, chacun disposerait alors d’une bourse non négligeable pour « se lancer dans la vie »… Les retombées favorables à attendre d’une telle mesure seraient si nombreuses, et spectaculaires, qu’elle mériterait d’être considérée en elle-même, la « bourse de départ » ayant à elle seule un potentiel énorme pour dynamiser l’économie dans son ensemble, en libérant l’initiative des jeunes, que ce soit pour entreprendre, pour choisir ses études ou pour faire le tour du monde. Au passage, il est probable qu’on améliorerait la paix dans les « quartiers », bien sûr, en redonnant un sens à la jeunesse – et, surtout, on en finirait avec la guerre absurde qui lui est livrée.
*
Il n’en reste pas moins qu’en l’état toute légalisation du cannabis ne peut que poser problème dans les « cités » où son économie pèse si lourd. Ainsi, les spécialistes de santé publique envisagent depuis longtemps cette légalisation avec effroi, craignant le report du marché noir sur d’autres substances qui resteraient illégales, les drogues dites « dures ». À cet égard, la politique de « réduction des risques » a largement démontré sa capacité à limiter considérablement le marché noir en proposant gratuitement des produits de substitution. La « RdR », comme on l’appelle, produit mécaniquement une sensible baisse de la délinquance, ainsi qu’elle améliore la santé comme l’économie des bénéficiaires de ces politiques déjà en œuvre depuis un quart de siècle.
Il pourrait être temps d’aller plus loin en la matière – il est vrai très loin de ce que peut concevoir le débat public au niveau zéro qu’il a atteint –, avec la distribution contrôlée de ces drogues dites « dures » aux personnes identifiées comme en état de dépendance. Une solution qui a parfaitement fait ses preuves[4], solution écartée pour les mêmes motifs dits « idéologiques » qui polluent et entravent toute politique en la matière.
Grande oubliée de la réflexion sur la « réduction des risques », l’expérience menée par le Dr John Marx, à Liverpool, pendant plus de dix ans, dans les années quatre-vingt, à l’échelle du Merseyside, le « grand Liverpool », où il proposait la distribution contrôlée d’héroïne – et de cocaïne ou de toute substance « posant problème » –, provoquant une cascade d’effets indiscutablement positifs : quasiment plus aucun mort par surdose ; incidence très faible du SIDA parmi les junkies ; abandon massif de la prostitution ; réduction drastique de la petite et moyenne délinquance ; stabilisation psychique des junkies ne connaissant plus le manque ; amélioration de leur santé, bien sûr, mais aussi de leurs rapports familiaux ; et, cerise sur le gâteau, disparition des dealers en même temps que leur clientèle dépendante se trouvait prise en charge par le docteur Marx, la clientèle récréative ne suffisant pas. Au résultat les plus fervents soutiens de l’expérience étaient parents, policiers et commerçants – trois catégories ordinairement très hostiles aux jeunes drogués…
*
Mais, plus encore que de savoir ce que feront les « dealers », c’est la question générale de la survie économique de ces zones sinistrées qui se pose dans l’hypothèse d’une disparition des « fours », en cas de légalisation du cannabis. Le bouleversement qui se profile là mérite amplement qu’on cherche à en tirer le meilleur plutôt que d’infliger plus de misère aux plus pauvres… Une politique de légalisation pourrait ainsi utilement prévoir de « favoriser les défavorisés », par exemple en accordant des privilèges à ce qu’on a qualifié un temps de « zones urbaines sensibles » et qu’on appelle maintenant « quartiers prioritaires ». Que ces « quartiers » soient effectivement « prioritaires » dans la circonstance, et se voient accorder un monopole sur la transformation, la diffusion ou même la production, pendant une dizaine d’années par exemple, le temps d’implanter une prospère économie de substitution à celle du marché noir, une économie légale et heureuse.
S’implanteraient là les nécessaires formations au commerce, et à la pharmacie du cannabis comme à tous les métiers du chanvre. Avec la non moins indispensable recherche pour assurer le développement de cette nouvelle industrie dans toutes ses dimensions, et en particulier la recherche médicale, si prometteuse et si négligée. Au centre d’un tel système, il y aurait des « coopératives » faisant fonction de centrales d’achat régulant le marché, garantissant la composition comme la traçabilité des produits, leur conditionnement et leur distribution. Un tissu d’économie associative, résolument « sociale et solidaire », aurait pour objectif rien de moins que le plein emploi et la revitalisation de ces « quartiers ».
La manne du cannabis légal serait ainsi orientée vers les fameux « territoires perdus de la République », qui expérimenteraient pour une fois autre chose qu’un « horizon bouché ». Les jeunes et moins jeunes auraient l’occasion de chevaucher la puissante vague verte qui déferle sur le monde entier. Car cette économie du cannabis, surtout si elle est envisagée dans son ensemble et optimisée, représente un fort potentiel pour l’économie globale à laquelle peut s’ajouter d’un coup un important secteur, une industrie nouvelle et plutôt écologique, indiscutablement « verte ».
*
Les avantages écologiques du chanvre sont si nombreux qu’on peinerait à les énumérer. Un seul pourrait, à lui tout seul, mériter attention, c’est la biomasse record de cette plante – qui ouvre d’importantes perspectives en termes de biocarburant ou d’énergie en général, ainsi que le soulignait déjà Jack Herer il y a plus de vingt-cinq ans[5]. À l’heure du réchauffement planétaire et de l’urgence à trouver des solutions, si le potentiel énergétique du chanvre n’est jamais pris en compte, alors même qu’il pourrait apporter une contribution essentielle au rétablissement d’un équilibre écologique – c’est bien l’idéologie qui prime, encore et toujours. Encore un exemple de la psychorigidité navrante du débat.
Mais il y a pire, si possible, en matière d’écologie, lorsqu’on regarde le cas des batteries au chanvre, déjà mises au point, et sensiblement supérieures aux actuelles piles au lithium. On sait que ces dernières posent un problème majeur de recyclage, et représentent même un drame écologique si l’on considère les énormes besoins de stockage d’énergie que demandent les si prometteuses énergies solaires et éoliennes. Téléphones, voitures et centrales pourraient ainsi être « propres », et le seront probablement un jour, les promoteurs de la batterie en chanvre étant « certains » de son avenir. En attendant, on a le droit d’être bête. D’une bêtise malheureusement criminelle, comme on peut voir en médecine.
Ainsi, les propriétés anti-tumorales du cannabis, donc anti-cancéreuses, sont étudiées depuis vingt-cinq ans maintenant dans le cadre d’un important programme de recherches, entrepris par Cristína Sanchez et d’autres à l’université Complutense de Madrid. Ces travaux ont démontré depuis longtemps l’efficacité du cannabis, THC ou CBD, en particulier contre le cancer du sein, si répandu que c’est un drame social – dénoncé de longue date comme féminicide –, mais aussi contre des tumeurs cérébrales, comme le si fréquent glioblastome – qui a emporté plusieurs de mes amis. Cela fait plus de quinze ans maintenant que les études dites « précliniques » ont été menées à bien, et on reste dans l’attente des études « cliniques » indispensables ; la seule finalement réalisée récemment a donné d’excellents résultats, mais on attend encore les nécessaires études complémentaires que GW Pharmaceuticals n’annonce toujours pas, après avoir tardé quinze ans pour cette première « étude clinique », même pas suivie donc, comme pour rien. Ainsi la cancérologie mondiale tourne le dos à des avancées décisives, incompréhensiblement, la connaissance s’accumulant sans que cela intéresse le moins du monde le corps médical, ni même les laboratoires pharmaceutiques, pourtant si friands de molécules efficaces. Fataliste, Cristína Sanchez reconnaît que si ses recherches avaient porté sur la laitue, il est probable qu’elle aurait déjà eu une homologation pour ce médicament qu’on tarde toujours à intégrer dans la pharmacopée, quitte à laisser mourir ceux que cela pourrait sauver…
Idéologie, préjugés religieux, tradition puritaine, forte imprégnation de cette tradition aux sommets des États et de leurs appareils policiers et militaires comme financiers ou universitaires : on trouve là une série de raisons, aux sources du mal qui ronge la perception de ces questions depuis la Renaissance, semble-t-il. Alessandro Stella a retrouvé la trace, dans les actes des tribunaux de l’Inquisition[6], au Mexique, dès 1600, du même débat qui tourmente la conscience occidentale depuis lors. Les Inquisiteurs combattaient une curieuse mode apparue dans la population coloniale, y compris dans la bonne société de la capitale, où l’on consommait non seulement du cannabis – lequel avait été très récemment importé des Philippines par les galions espagnols, et très vite acclimaté et adopté au Mexique –, mais aussi du peyotl, le fameux cactus à mescaline. Cannabis et hallucinogènes : tout comme feront plus tard les hippies, après quelques siècles de prohibition « réussie » donc. On aura ainsi compris que les mêmes inquisiteurs faisaient possiblement surtout la « chasse aux drogues » en persécutant les « sorcières » en Europe à la même époque. Une opération rondement menée. Au sortir de cette nuit pharmacologique, au XVIIIe siècle dit des Lumières, tout au plus entendra-t-on parler d’empoisonneuses. La seule drogue en vogue, le café, coupait toute ébriété. Même l’alcool, le vin, ne se boira quasiment plus qu’avec élégance, et de préférence avec des bulles…
Il faudra attendre le milieu du XIXe, avec le psychiatre Moreau de Tours et son Club des haschischins – dans un hôtel particulier de l’île Saint-Louis, 17 quai d’Anjou, où bien des grands écrivains du temps se retrouveront –, pour qu’on entende parler de drogues autrement que d’un point de vue religieux diabolisant. Et encore retiendra-t-on surtout le moralisme d’un Baudelaire dénonçant les Paradis artificiels. Un peu avant, les Confessions d’un mangeur d’opium, de Thomas de Quincey, témoignent de la réalité d’un amateur de laudanum, la teinture d’opium qui sera si populaire outre-Manche, également consommé par Baudelaire ou Balzac, vendue en pharmacie sur ordonnance, en France, alors que son commerce était libre en Angleterre – les Anglais ne consommant pas moins d’opium que les Chinois, au long du XIXe siècle, la drogue accompagnant leur révolution industrielle.
Plus anecdotiquement, en fin de siècle, aussi en Angleterre, Havelock Ellis testait la mescaline, et en Autriche Freud découvrait les vertiges de la cocaïne. Dans le même mouvement, profitant des possibilités nouvelles offertes par les seringues hypodermiques, on voit des médecins adopter pour leur usage personnel la morphine, comme en témoignera l’écrivain russe Boulgakov. Un peu plus tard, c’est un poète français, Antonin Artaud, qui ira expérimenter le peyotl, dans la sierra Tarahumara. Mais il faudra attendre les années 1950 pour qu’un banquier américain, Robert Gordon Wasson, découvre les champignons hallucinogènes du Mexique. Tous ces aventuriers de l’esprit étaient les pionniers d’une révolution à la fois pharmacologique et culturelle qui aura réellement démarré alors, mais qui connaît depuis plus d’un siècle maintenant de sacrés vents contraires.
L’histoire est méconnue, mais on doit à l’ambassadeur de France en poste à Rome de 1897 à 1924, Camille Barrère, d’avoir pris l’initiative d’un Office international de l’hygiène publique, qui sera installé à Paris en 1907, et accouchera aussitôt de conférences internationales, à La Haye puis à Shanghaï, au cours desquelles seront adoptées les premières conventions prohibant l’opium, en 1909 et 1912. Lorsque la loi française intègre cette prohibition, en 1916, le même Artaud pourra protester au nom de la conscience et du droit de chacun à juger de sa douleur, sans être vraiment entendu. Le drame de l’application furieuse d’une législation inepte avait au contraire une longue carrière devant lui, jusqu’à Gérald Darmanin, dernier avatar d’une lignée plutôt lourde de démagogues dangereux. Envers cette engeance, Artaud n’était pas tendre : « Monsieur le législateur de la loi de 1916, agrémentée du décret de juillet 1917 sur les stupéfiants, tu es un con », « ce n’est pas par amour des hommes que tu délires, c’est par tradition d’imbécillité. Ton ignorance de ce que c’est qu’un homme n’a d’égale que ta sottise à le limiter. »
Entre deux guerres, la prohibition ne fera que se renforcer, les conventions internationales s’étendant même alors au cannabis. Aux États-Unis, c’est le redoutable Harry Anslinger, qui substituera cette nouvelle prohibition de la marijuana à celle de l’alcool, et déchaînera une vague de campagnes aussi hystériques que racistes, contre les usagers noirs ou mexicains de préférence, accusés quotidiennement de violer et de tuer des femmes blanches sous l’emprise diabolique de la drogue – à la une de la presse à sensation dont Hearst, modèle de Citizen Kane, radicalisait alors les techniques. Mais en Europe, c’est dès leur prise du pouvoir en 1933 que les nazis engageaient à grande échelle la chasse aux drogués, symboles de la supposée « décadence » de la République de Weimar que le nouveau régime entendait abolir. Dénoncés par leurs médecins ou par des comités sanitaires de quartier, les toxicomanes finissaient en cure de désintoxication, pour les « aryens », ou partaient directement en camp, pour les autres. Ce qui n’empêchait pas qu’à la tête de l’État Goering fût morphinomane, tout comme Ansliger aux États-Unis d’ailleurs.
On constate toutefois que c’est surtout depuis un demi-siècle, en gros depuis la Convention de 1961, que s’est instaurée la parfaite universalisation de cette idéologie puritaine qui fait loi aux quatre coins du monde – ainsi que l’ambitionnaient les premières conférences prohibitionnistes, dès 1909. De 1600 à nos jours, des siècles de « prohibition », en organisant ce qui a longtemps fonctionné avec la force d’un tabou, auront laissé leur empreinte dans la culture, c’est sûr. Et de même que l’Inquisition, sortie du fond du Moyen âge, aura connu une belle prospérité avec la Renaissance, l’obscurantisme de la prohibition des drogues a déferlé à l’âge de la science avec la foi du charbonnier.
Et pourtant… Depuis les années cinquante, grâce aux écrivains beatniks apparus à San Francisco, puissamment renforcés par la promotion des champignons du Mexique puis du LSD dans Life – le magazine à plus grand tirage –, ce qu’on a appelé la « contre-culture » s’est propagée tant et si bien qu’à la quatrième génération elle a tout recouvert, pas seulement la musique et les arts populaires comme les techniques, mais bien l’ensemble de la société. Tout le monde a été jeune… Ainsi l’État se retrouve dans une singulière posture, tout imprégné de cinq siècles de puritanisme, confronté à une « jeunesse » qui proclame à l’inverse un hédonisme qu’on pourrait qualifier de normal, tant il répond aux besoins fondamentaux de détente, de fête ou de sexualité, essentiels à toute vie humaine et plus encore à la vie en société.
Ainsi, depuis plus d’un demi-siècle, s’affrontent avec constance d’un côté curés et militaires, de l’autre adolescents et poètes, pour savoir jusqu’où peut aller le droit de vivre. L’expérience intime de chacun le conduit toujours à rechercher ce qu’on pourrait appeler des dérivatifs aux tensions qu’on rencontre inévitablement. Des soupapes sont organisées sous forme de « fêtes » nationales – ce qui ne convainc personne. Les vraies « fêtes », d’origine plutôt religieuse, se terminent en beuveries. Seul le Carnaval – vieille tradition devenue splendide sous les tropiques –, concentre l’esprit de la fête, où tous les corps se relâchent pour la danse et pour l’amour. Les hippies auront incarné cet esprit, en même temps qu’ils auront eu l’intuition de la nécessité écologique, opérant le court-circuit qui s’imposait dans la pensée politique. Après un demi-siècle de débats, certaines évidences, comme le risque nucléaire ou l’urgence climatique, s’imposent difficilement, ainsi qu’on le vérifie même après la catastrophe, et quand il n’y a plus vraiment le choix.
Née de ce cri primal qu’on doit à l’adolescence, revendiquant le droit de disposer de soi, de son corps comme de son esprit – véritable soulèvement contre une tradition puritaine multiséculaire –, cette contradiction insoutenable dans la culture devrait évoluer à mesure que les jeunes accèdent au droit de vote, une génération après l’autre, et finir par se résoudre démocratiquement. On pourrait même dire qu’elle est déjà résolue, après un quart de siècle où l’on a pu voir le cannabis serial winner d’élections, que ce soit avec la succession de référendums américains, remportés le plus souvent par de très larges majorités, ou même lors d’élections générales comme au Canada et même avant en Uruguay. La force et la constance de l’avis populaire – en dépit d’une propagande éhontée et des préjugés religieux imprégnés depuis si longtemps – disent bien combien l’affaire est pliée : la prohibition s’impose contre la volonté très majoritaire des citoyens – ce qui devrait d’emblée se comprendre comme un non-sens sous un régime à prétention démocratique.
Aux États-Unis, la comédie atteint un paroxysme, puisque la population s’est exprimée aussi clairement pour un « changement de logiciel », au point que plus de la moitié des États ont déjà changé leurs lois, mais l’État fédéral n’en maintient pas moins sa législation draconienne, alors même que les électeurs disent qu’ils n’en veulent plus. Cette contradiction dans l’état de droit permet aux banques, par exemple, de manifester leur propre puritanisme prohibitionniste en s’abritant derrière les lois fédérales pour refuser d’ouvrir des comptes à l’énorme clientèle de l’économie légale verte qui est apparue dans le pays. Le commerçant légal, installé avec pignon sur rue par la volonté populaire, se retrouve ainsi soumis à l’impôt sans pour autant avoir accès normalement à des services bancaires, toute une catégorie professionnelle se retrouvant absurdement entravée, certes légale mais comme marquée du sceau de l’infamie de commerçants « pas comme les autres ».
Dans le même temps, les lois fédérales enferment toujours pour de longues durées des justiciables qui ont la malchance de se trouver dans un État où l’on sanctionne lourdement ce qui est une activité légale dans l’État d’à côté. Pourtant, dès 1996, la Californie – le plus peuplé des États américains –, votait la légalisation du cannabis thérapeutique avec une majorité de plus 70 % des suffrages. C’était il y a un quart de siècle. Rappelons qu’il s’agit non seulement d’un des États les plus riches de la planète – devançant la France et l’Inde au palmarès –, mais aussi d’un des plus éduqués, avec une concentration d’universités de haut niveau plus qu’enviable. Un pays qui fonctionne depuis un siècle comme la locomotive du monde, de Hollywood à la Silicon Valley.
On irait un peu vite en concluant, comme Artaud, qu’il y aurait d’un côté l’intelligence, de l’autre la bêtise… Mais l’indigence des argumentaires prohibitionnistes est une des raisons de leurs échecs quasi systématiques dans les urnes, dès lors qu’il y a un débat public approfondi sur la question. C’est que le dossier scientifique est sans appel, et on a pu vérifier comment les prescriptions internationales elles-mêmes, gravées dans le marbre des conventions onusiennes, auront oublié de se fonder sur une documentation sérieuse pour interdire le cannabis – et l’OMS tente poussivement d’y remédier, sous les feux croisés des pays prohibitionnistes et anti-prohibitionnistes qui siègent dans sa commission des stupéfiants. Grand progrès, depuis 2020, l’usage thérapeutique du cannabis, connu de la pharmacopée depuis la plus haute antiquité, est enfin reconnu, après une soixantaine d’années de classification parmi les substances « sans aucun intérêt » médical, une affirmation qui dit tout sur le degré d’« objectivité », non seulement des institutions sanitaires onusiennes mais aussi de l’ensemble des législations qui s’en sont inspirées.
Pourtant, dès le début des années soixante-dix, le docteur Lester Grinspoon – décédé l’an dernier – avait corrigé l’erreur. Ayant été mandaté par les autorités sanitaires américaines pour vérifier la dangerosité du cannabis, il s’était penché sur la question pour constater au contraire que rien ne pouvait justifier sa prohibition, en tout cas du point de vue médical supposé fonder une législation adoptée au nom de la santé publique. Grinspoon publiera alors Marihuana reconsidered, magistral exemple d’honnêteté intellectuelle, le chercheur reconnaissant avoir dû « reconsidérer » sa position initiale au vu des résultats de son étude, pour conclure à l’absurdité des lois en vigueur dont il proposait qu’elles soient aussi « reconsidérées ». Un pavé dans la mare.
Lester Grinspoon était non seulement un chercheur émérite, dont la rigueur scientifique n’était ni contestée ni contestable, mais de plus un individu très raisonnable et même éloquent, avec toutes les qualités d’un excellent pédagogue. Il n’aura pourtant pas été entendu. Et c’est bien dommage car on était alors au tout début des années soixante-dix. La catastrophe carcérale et sociale était encore à venir. Or on connaissait parfaitement les effets pervers d’une politique de prohibition, l’expérience de l’alcool dans les années trente ayant été assez éloquente. Soixante années d’application de la Convention unique de 1961 ont permis de vérifier dramatiquement comment les mêmes causes produisent les mêmes effets, sauf que cette fois c’est à l’échelle mondiale que cette mauvaise politique a fait des dégâts de très grande ampleur – et certains voudraient encore en rajouter.
On voit bien qu’à chaque étape, l’État prohibitionniste ne se détermine qu’en fonction de son parti pris idéologique. Et on comprend ici que cette forme particulière de la pensée – qui n’en est pas une au sens où elle refuse d’appréhender des réalités complexes, persuadée de les connaître par avance, du haut de cette superbe ignorance qu’on appelle la foi, la foi en une « idée » –, cette prétendue pensée ne fonctionne que sur une modalité extrêmement pauvre, réduite à raconter des « histoires ». Elle n’en fonctionne pas moins, et s’avère plutôt performante, et même parfaitement adaptée, lorsqu’il s’agit de gérer un conflit en recourant classiquement à la propagande – et au mensonge – pour mieux l’intensifier.
S’il s’agissait de départager les opinions, il semble clair aujourd’hui que les partisans de la guerre totale – grands organisateurs du chaos des drogues, découpeurs de sociétés, animateurs d’une perpétuelle chasse à l’autre –, n’ont pas forcément la meilleure recette, surtout s’il s’agissait d’arrêter la course à l’apocalypse. On leur opposerait volontiers la paix des drogues, une vieille revendication qui n’aura rien perdu de son actualité tant qu’on enfermera massivement des humains pour des infractions sans fondement. La paix des drogues, c’est non seulement la meilleure façon de réduire la violence, et une vraie promesse pour notre pharmacopée, mais une grande chance pour l’économie comme pour l’écologie, et un progrès sensible pour les libertés. Un meilleur choix.
L’appétit pour les fleurs de CBD – menacées de se voir renvoyées dès l’an prochain dans l’enfer des « fours » –, est un curieux phénomène. Découvertes par des hippies lassés de se droguer, et intégrées rapidement parmi les nouveaux modes de vie urbains, leur popularité semble comme une réaction, qu’on pourrait dire « interne », à l’hédonisme revendiqué par la « contre-culture » il y a un demi-siècle. Plus largement, ces fleurs révèlent spectaculairement une aspiration insoupçonnée à plus de sobriété. Elles offrent en fait un substitut idéal à toute forme d’ébriété, apportant l’apaisement que l’on demande d’abord aux drogues, comme à l’alcool et au tabac. Avant qu’apparaisse cette mode du CBD, on ne savait isoler cet effet spécifique d’apaisement, toujours peu ou prou mêlé à l’ivresse, dont on découvre qu’elle viendrait comme en supplément, et qu’elle peut être tout autant désirée par beaucoup qu’indésirable pour certains.
On pourrait parler là d’une découverte majeure. Ce qui serait recherché en consommant des substances qui altèrent la perception, ce serait, dans bien des cas, un simple calmant. L’opium en serait parfait exemple, lorsqu’on voit tant de personnes souffrant de douleurs chroniques n’aimant pas y recourir à cause de l’effet psychotrope puissant qui accompagne le soulagement de la douleur que procurent les opiacés. Il y aurait de même un malentendu pour nombre de fumeurs de cannabis psychoactif, avec THC, qui découvrent qu’ils recherchaient plutôt la même chose sans THC, sans effet psychoactif, mais avec CBD, et son simple effet apaisant. Et lorsque je sors du boulot et que je m’arrête pour demander un whisky au comptoir du bistrot, est-ce l’ivresse que je cherche, ou simplement à me détendre ?
Ainsi, la vieille problématique de la prohibition serait dépassée. Ce sont les drogués eux-mêmes qui en ont marre de se droguer… Cette conclusion est si inattendue qu’on peine à en mesurer la profondeur. Il faut imaginer que demain, si par malheur ces fleurs devenaient inaccessibles dans le marché légal, leurs clients ne retourneront pas au THC mais chercheront du CBD, même illégal, que leurs dealers n’auront pas trop de mal à trouver puisque les mêmes fleurs resteront légales en Europe et particulièrement dans les pays frontaliers. Mais d’honnêtes consommateurs de cette fleur « apaisante » au CBD non psychotrope iront s’approvisionner dans les « fours » s’il le faut, jusqu’au fond des quartiers les moins rassurants, « sensibles » et « prioritaires », souvent plutôt glauques. Et pourquoi ? Parce qu’ils ne veulent plus se « droguer »…
Que l’État ne comprenne rien à un tel phénomène, c’est normal. Il n’est pas prévu pour. Sa vision binaire – divisant le monde en amis et ennemis, comme le recommandait Carl Schmitt –, n’a que faire de telles subtilités. Il mène ses batailles frontalement, et ce qui ressemble à un pas de côté des hippies aura tant déstabilisé le gouvernement français qu’il n’aura eu de cesse de chercher une « parade », jusqu’à accoucher de ce monstre juridique qui voudrait qu’on puisse persécuter jeunes et moins jeunes non plus parce qu’ils se drogueraient mais par association symbolique, ou faut-il dire culturelle, où ce n’est plus une substance qu’on pourchasse mais sa forme de fleur…
Le droit permettrait ça ?
La Cour de cassation s’est prononcée deux fois très clairement et la Cour européenne des Droits de l’Homme avant elle, sur l’indiscutable légalité du CBD dans son ensemble, sous toutes ses formes. De son côté, la Commission des Stupéfiants de l’ONU s’est réunie pour débattre d’une résolution confirmant la légalité du CBD, et proposant la limite de 2 % de THC pour déterminer la « toxicité » de la plante, très au-delà du 0,2 % qu’on ne peut obtenir qu’artificiellement aujourd’hui, au détriment de la qualité des fleurs. Personne n’aura contesté le bien-fondé de ce texte, mais il n’aura finalement pas été adopté, « puisque le CBD n’était pas interdit » et qu’il n’y avait pas de raison pour « légaliser » ce qui est autorisé.
On en est pourtant là, dans la plupart des États du monde, où le statut du CBD est incertain. En Espagne, dans l’esprit de cette non-résolution de l’ONU, règne un statut qualifié de « a-légal » par les juristes, incertitude qui n’aide pas à l’interprétation, et qui tendrait à ce que seuls les cosmétiques soient à l’abri des tracasseries policières. Les tribunaux auront depuis peu relâché la pression, sur la base de la jurisprudence européenne, considérant qu’il ne pouvait qu’être légal de commercialiser dans un pays européen ce qui se produit légalement dans un autre pays européen. Cette heureuse conclusion n’empêche pas que l’insécurité juridique caractérise toujours la situation – et que les commerçants vivent dans la crainte de se voir reprocher ce qu’ils savent légal, mais pas vraiment à en croire la Guardia civil quand elle débarque avec ses gros sabots.
En France, il semble que la passion pour les calmants de toutes espèces ait trouvé avec le CBD l’occasion de s’exprimer encore une fois. Longtemps premier consommateur d’alcool, ce pays est depuis assez longtemps maintenant premier consommateur de cannabis et, plus encore, de tranquillisants fournis en pharmacie et généreusement ordonnés par les médecins. Le CBD s’inscrirait ainsi dans la lignée. On a vu le phénomène recouvrir le pays, les boutiques de CBD apparaissant dans tout le territoire, dans les bourgs comme dans les villes, en un temps record. Ce qui était inconnu la veille est devenu soudain banal. On en retrouve au supermarché comme au bureau de tabac, et des campagnes 4X3 s’étalent sur les quais des métros, comme les spots de publicité à la télévision.
Dans cette ambiance de totale normalité, qui s’imaginerait que le gouvernement soit pressé de s’en prendre aux boutiques, qui tirent l’essentiel de leurs revenus de la vente de ces fleurs, dont aucune ne pourrait survivre si l’interdiction proposée entrait en vigueur ?
Qui veut de ça ?
La police, le gouvernement, la présidence, contre un pays. Un pays qui demande à vivre et où on aimerait pouvoir respirer librement les fleurs de jolies plantes qu’il s’agit d’interdire, sans aucune bonne raison, alors qu’elles sont légales, en condamnant un marché avec ses boutiques et ses milliers de travailleurs, seulement pour exhiber une fois de plus l’autorité mortifère de l’État.
TU L’AS DIT, EFENDI !
Michel Sitbon
Cet article a été publié sur le site de Guerre Moderne auquel Legalize est associé.
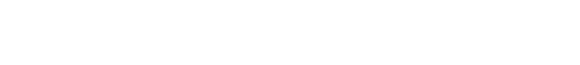
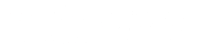

0 commentaires